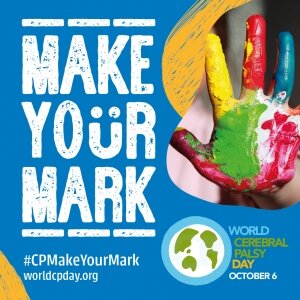Vous vous demandez pourquoi il serait avantageux pour vous ou votre enfant de participer à la recherche axée sur le patient? Dans notre série de billets « Mon pourquoi », cinq patients partenaires du Réseau BRILLEnfant nous expliquent les nombreuses raisons pour lesquelles ils ont décidé de participer à la recherche.
Dans ce billet, Frank Gavin, directeur de l'engagement des citoyens du Réseau BRILLEnfant, nous parle de son « pourquoi ».
J’étais enthousiaste, mais ma femme l’était un peu moins, à l’idée d’inscrire notre fils à une étude de recherche alors qu’il avait 12 ans. Nous l’avions découverte en lisant un prospectus dans le bureau du médecin qui avait récemment diagnostiqué le trouble du spectre de l’autisme chez notre fils et qui était le chercheur principal de cette étude.
Ma femme et moi avions plusieurs questions. Pourquoi, par exemple, ses résultats scolaires étaient-ils si inconstants? Pourquoi angoissait-il face à des choses en apparence très anodines? Que pouvions-nous faire pour soulager sa souffrance? Nous avions soif de réponses ou, à tout le moins, de renseignements qui pourraient mener à des réponses. Cette étude, nous le savions, n’était que partiellement reliée à nos principales préoccupations, mais elle nous semblait plus pertinente que les autres. Bien entendu, nous ne pouvions imaginer qu’il soit possible pour des parents comme nous de contribuer à l’élaboration d’un projet de recherche qui se pencherait directement sur les questions que nous nous posions.
Le formulaire de consentement indiquait clairement que nous ne devions pas nous attendre à recevoir beaucoup de renseignements concernant précisément notre fils, mais on nous avait promis un rapport de trois pages sur son cas et une rencontre avec la chercheuse débutante qui l’accompagnerait dans la réalisation des diverses tâches. Comme nous étions avides de renseignements dans les mois qui ont suivi le diagnostic, nous étions convaincus qu’il valait la peine de surmonter l’énorme difficulté de faire manquer trois demi-journées d’école à notre fils pour aller l’asseoir dans un immeuble de béton pas très accueillant pour les enfants, doté de minuscules fenêtres, afin de lui faire faire des tâches difficiles – tout cela, bien entendu, en étant observé de près par des étrangers. Il a trouvé ça pénible.
Quelques mois plus tard, je me suis rendu au centre-ville pour assister à la rencontre avec l’étudiante de troisième cycle qui avait réalisé les tests et rédigé le rapport qui devait m’être remis et expliqué lors de cette réunion. Malheureusement, à mon arrivée, on m’a averti que l’étudiante ne serait pas au rendez-vous, en raison d’une chute de neige de quelques centimètres – vraiment pas grand-chose, même selon les normes torontoises – et que je recevrais le rapport par la poste. J’étais trop découragé pour demander un autre rendez-vous. Le rapport que nous avons finalement reçu par la poste était d’une utilité moyenne. Je crois qu’il aurait été plus utile si nous avions pu en discuter avec son auteure ou même si nous avions simplement pu lui poser quelques questions.
Depuis cette expérience, survenue il y a plusieurs années, j’ai collaboré à titre de conseiller et partenaire auprès de plusieurs projets de recherche, notamment au sein du Réseau BRILLEnfant. J’espère qu’en travaillant ensemble, nous (les chercheurs, les parents et les jeunes) pourrons nous assurer que la recherche se penche sur les principales questions que nous nous posons et qu’elle le fasse d’une manière respectueuse et enrichissante pour les enfants, les jeunes et les familles qui, en tant que participants ou sujets de recherche, contribuent de façon si généreuse et indispensable à cette recherche.