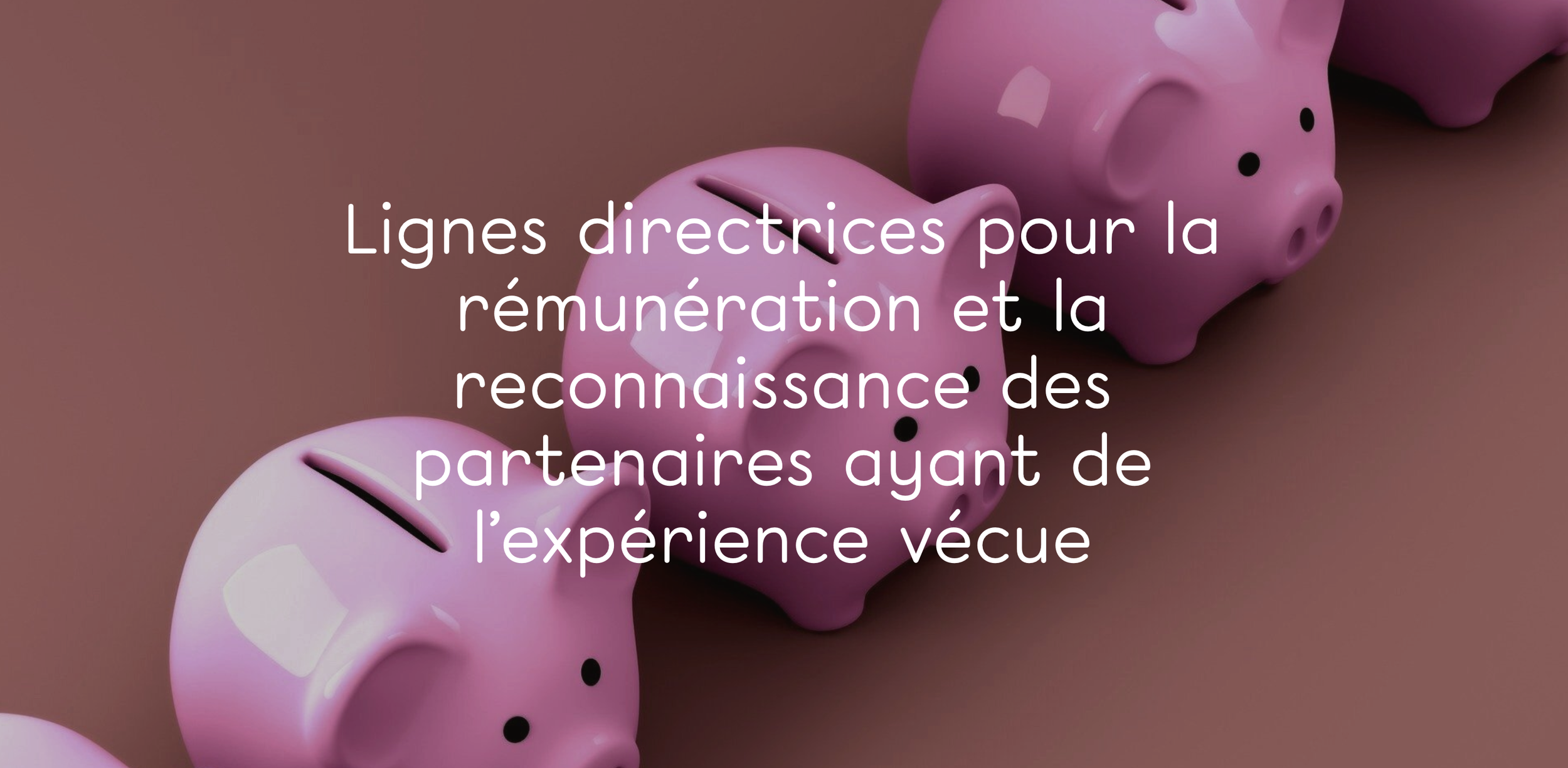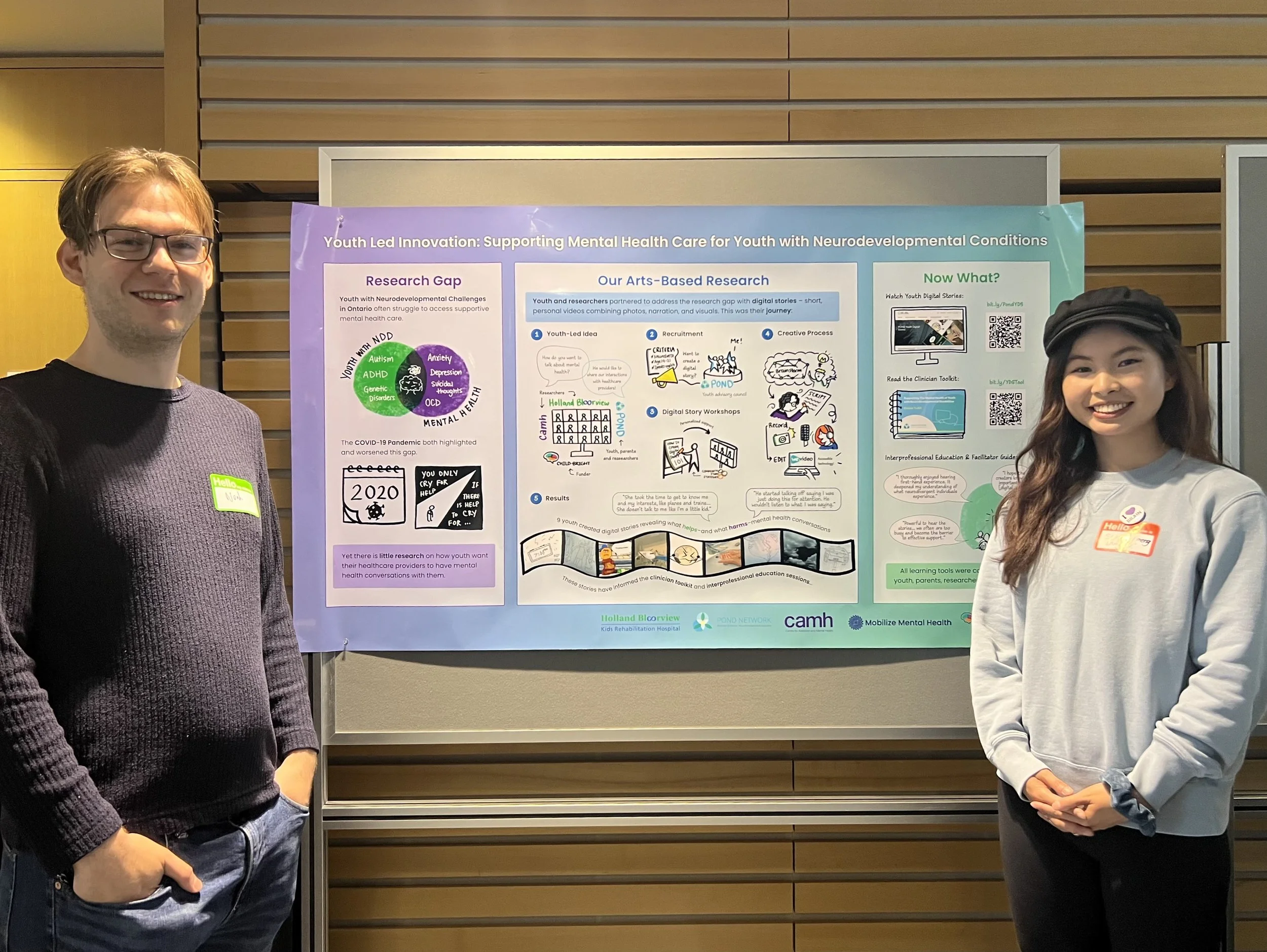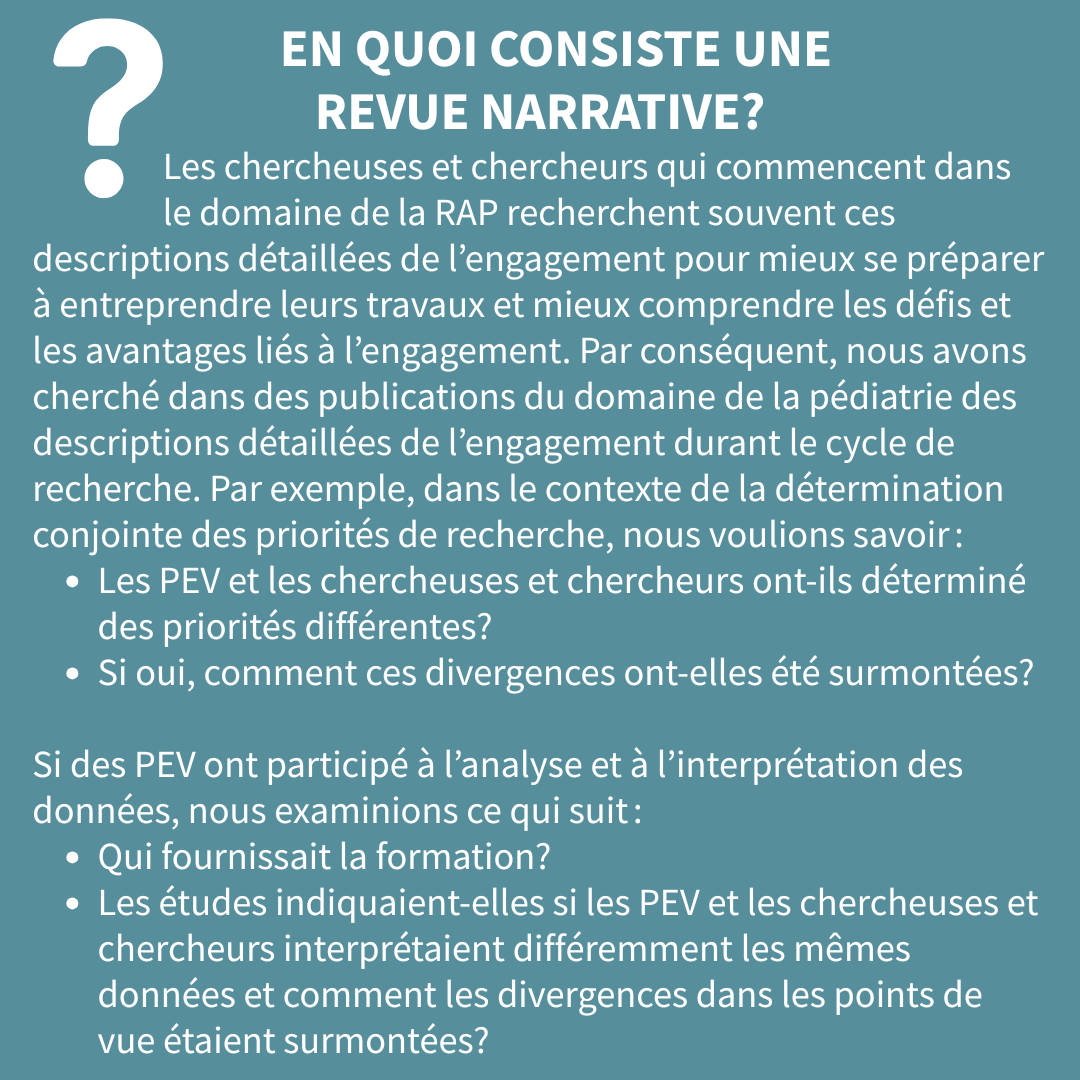Kian maîtrise très bien la technologie, il est drôle et espiègle, et il a l’esprit aventureux. Il fait preuve d’une immense empathie, dans une mesure que j’ai rarement vue chez les autres. Lorsque j’ai reçu mon diagnostic de trouble bipolaire, j’ai commencé à réfléchir à la stigmatisation à laquelle j’étais confrontée et que j’intériorisais, et à la façon dont les expériences quotidiennes de Kian contrastaient avec les miennes. Je peux masquer mon trouble bipolaire, mais Kian ne peut pas cacher son handicap physique. En même temps, les suppositions que font les gens sur Kian et celles qu’ils font sur le trouble bipolaire sont démoralisantes. En ce sens, nous avons un lien très profond.
Quand je pense à l’avenir de Kian, je me demande comment la société le traitera lorsqu’il prendra de l’âge. L’empathie du public semble drastiquement changer lorsqu’il est question de handicaps. Même si les gens éprouvent souvent plus de compassion pour les enfants, ils peuvent en ressentir moins lorsqu’une personne atteint l’âge adulte.
C’est toujours aux côtés de Kian que je réalise des activités de défense des intérêts dans des milieux médicaux, scolaires et sociaux, en priorisant sa voix et en respectant sa dignité, son autonomie et ses droits, tels qu’ils sont décrits dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des personnes handicapées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Au fil du temps, j’ai dû lâcher prise sur mon approche initiale de parent hélicoptère et permettre à Kian de vivre de manière authentique, comme ce devrait être le cas de tous les enfants. Je me souviens d’un moment pendant une marche pour recueillir des fonds. Kian était seulement âgé de quatre ans et il voulait monter une pente raide avec son fauteuil électrique. Au départ, j’ai hésité, car je ne savais pas si je devais le laisser faire, mais je me suis rapidement rappelé ceci : si Kian était un enfant de quatre ans normal, est-ce que j’hésiterais? Bien sûr que non. Je l’ai donc laissé monter la côte avec son infirmière. Il s’est amusé comme un petit fou et je n’oublierai jamais son sourire ce jour-là.
Lorsque je réfléchis à cette conversation que j’ai eue avec mon généticien en 2009, je comprends maintenant la vérité de ses paroles. Le problème n’a jamais été Kian, le problème était la façon dont le monde le voyait, ou plus exactement, la façon dont il ne le voyait pas. La société, les travaux de recherche, les politiques et les lignes directrices cliniques ne tiennent pas toujours compte de Kian comme moi je le fais et de la façon dont il se voit. Cette prise de conscience a attisé mon désir de participer à des activités de défense des intérêts et de recherche en vue de réclamer des améliorations de l’équité en santé pour Kian et d’autres comme lui au Canada. Elle m’a aussi permis de comprendre l’importance de reconnaître la neurodivergence pour créer de meilleurs systèmes de soutien avec des enfants en situation de handicap et leurs familles.
Nourrir l’amour radical dans la recherche neurodéveloppementale
Dans son livre À propos de l’amour, bell hooks, universitaire et théoricienne critique de la race, indique que pour aimer, il faut six ingrédients : l’attention, l’engagement, la connaissance, la responsabilité, le respect et la confiance. Elle fait valoir que l’amour est essentiel à la justice sociale et que l’amour radical peut toutes et tous nous unir, en reliant des mouvements sociaux et en faisant avancer nos progrès collectifs.
Dans le domaine de la recherche sur les handicaps, l’amour radical, ce peut être la création d’espaces où les personnes peuvent se rassembler, se sentir en sécurité et s’exprimer de façon authentique. L’amour, ce peut être de veiller à ce que nos résultats de recherche pour le public soient rédigés en langage clair, ce qui fait en sorte qu’ils sont faciles à comprendre, concis et accessibles à tout le monde. L’amour, ce peut être de répondre à des demandes de mesures d’adaptation sans jugement, en offrant de l’aide et en témoignant de l’attention. L’amour, ce peut être de s’efforcer de comprendre, plutôt que de laisser libre cours à la stigmatisation associée à un diagnostic de maladie mentale.
Mes différentes expériences vécues ont profondément influencé mon parcours universitaire et professionnel, et elles m’ont amenée à poursuivre des travaux de recherche utiles qui relient mes univers personnel et professionnel. Les travaux de recherche que j’effectue dans le cadre de mon doctorat portent principalement sur les intersections de la race et des handicaps, et examinent précisément les expériences des familles noires, autochtones et racisées dont des membres ont reçu des diagnostics de santé mentale et celles de leurs enfants en situation de handicap dans le système de protection de l’enfance. Guidée par le cadre conceptuel autochtone (en anglais seulement) de Margaret Kovach, professeure autochtone d'ascendance Nêhiyaw et Saulteaux du Traité 4 et membre de la Première Nation Pasqua, je me fonde sur l’épistémologie autochtone, l’éthique, la communauté et le moi de l’expérience dans les relations.